
La diva béninoise : Angélique Kidjo
La douce bouffée d'Angélique Kidjo chantant Lemanja remplit l'air enveloppant et accueillant les invités à l'approche de l'entrée menant à la boutique KOKOBÉRNA .
Angélique Kidjo représente globalement ce qui est - le divin féminin africain, aux côtés de nos ancêtres tels que la bien-aimée Miriam Makeba, la féroce reine Amina, la exigeante reine Moremi et de nombreuses autres aïeules à travers le continent, y compris la nouvelle génération de jeunes contemporains brillant la lumière sur notre patrimoine, le maintien de nos traditions, notre essence
Nous, les conteurs originaux... ceux qui savent d'où ils viennent
Comme le crieur public des villages africains précoloniaux passés
Il y a un proverbe africain, "se perdre c'est trouver le chemin"
J'espère que ce qu'elle a fait pour l'Afrique de l'Ouest à travers son travail dans la musique, le cinéma et le théâtre - puisse être illustré dans l'embellissement qui découle de KOKOBÉRNA à vous, nos clients.
Lisez l'article, cliquez sur les liens, explorez, plongez, soyez curieux, restez ouvert, posez des questions, laissez vos pensées et commentaires ci-dessous.
En Gratitude.
==========
Angélique Kpasseloko Hinto Hounsinou Kandjo Manta Zogbin Kidjo, connue sous le nom d' Angélique Kidjo , est une auteure-compositrice-interprète, actrice et militante béninoise cinq fois récompensée par un Grammy Award, connue pour ses diverses influences musicales et ses vidéoclips créatifs. Kidjo est né dans une famille d'artistes interprètes. Actuellement présenté sur la couverture de Forbes Africa, ci-dessous est l'article complet et complet extrait du New Yorker Magazine. Interviewé par Julian Lucas, février 2022.

A soixante et un ans, la doyenne de la pop africaine enregistre avec tout le monde, de Burna Boy à Philip Glass, et toujours à la recherche de nouveaux rythmes. ~ par Julien Lucas
À l'âge de vingt et un ans, Angélique Kidjo chantait dans plus de langues que la plupart des gens ne comprendront jamais. La diva béninoise a reçu sa première standing ovation à six ans, pour une interprétation impromptue d'une mélodie traditionnelle Fon au théâtre de sa mère. Avant longtemps, elle était passée au yé-yé français, au makossa camerounais et à la reprise de Miriam Makeba avec son groupe de lycée.
Après que le premier album de Kidjo en ait fait une star nationale, sa famille craignait que le gouvernement béninois, sous le dictateur Mathieu Kérékou, ne l'empêche d'aller à l'école en France. Ils ont organisé une évasion nocturne sans autorisation officielle; heureusement, le douanier de l'aéroport était fan.
Kidjo s'est inscrite au Centre d'informations musicales , une école de jazz à Paris, et s'est immergée dans la scène émergente des musiques du monde de la ville. Son premier album avec Island Records, « Logozo » (1991), l'a propulsée au sommet des classements musicaux internationaux, en grande partie grâce au tube de danse fanfaron « Batonga ». (Kidjo est apparu sur la couverture de l'album dans une combinaison à imprimé zèbre.)
Son suivi était le joyeux ver de l'oreille « Agolo », dont le clip emblématique célébrait la maternité et les divinités africaines plus de deux décennies avant qu'une Beyoncé enceinte organise une séance photo virale en tant qu'Oshun, la déesse de la rivière Yoruba.
Non content de la célébrité pop, Kidjo s'est lancé dans une mission défiant les genres pour chanter la diaspora électrique. Dans « Fifa » (1996), elle a enregistré avec des percussionnistes dans des villages du Bénin lors d'un road trip à travers le pays ; Vient ensuite une trilogie globe-trotter explorant les racines africaines des traditions musicales aux États-Unis, au Brésil et dans les Caraïbes.
Kidjo vient de l'ancien port d'esclaves de Ouidah, dont la religion vodun a laissé une marque déterminante sur la diaspora - un fait qu'elle a habilement utilisé pour se positionner comme son médium musical le plus mondain. Comme elle a plaisanté une fois sur la couverture de Jimi Hendrix, « Qui pourrait mieux prétendre être un« enfant vaudou »que moi? ”
Au cours des années qui ont suivi, Kidjo a imaginé des expériences toujours plus surprenantes, des interprétations d'albums de Celia Cruz et des Talking Heads à un arrangement vocal solo du « Boléro » de Maurice Ravel, qui se déploie en chants rythmiques envoûtants. Elle a remporté quatre Grammys et a travaillé avec Santana, Questlove, Alicia Keys, Sting et Yo-Yo Ma.
Sa dernière sortie, "Mother Nature" (2021), nominée aux Grammy Awards, est un cri de cœur contre le réchauffement climatique et la corruption politique, mettant en vedette des superstars africaines du millénaire telles que M. Eazi, Yemi Alade et Burna Boy. L'album va de la rumba congolaise au hip-hop d'Atlanta, mais la voix de Kidjo est constante, un instrument d'une telle puissance et d'une telle clarté qu'il semble tout aussi capable de polir du verre ou d'annoncer le Jour du Jugement.
Kidjo vit à Brooklyn, mais quand je lui ai parlé fin janvier, via Zoom, elle était au Cap pour le tournage de « The Woman King ». Mettant en vedette Viola Davis et John Boyega, le film mettra en scène les exploits des Amazones dahoméennes, une unité militaire légendaire entièrement féminine dans ce qui est aujourd'hui le sud du Bénin .
Kidjo n'a pas pu discuter de son rôle dans le film, mais elle a longtemps parlé de l'héritage stimulant des guerriers. Beaucoup de ses chansons les plus célèbres sont en fon, dont les monosyllabes percussives lui confèrent sa complexité de phrasé ; elle l'appelle "la langue des Amazones". Notre conversation, qui s'est déroulée en anglais, a été éditée et condensée.
Que pouvez-vous partager sur votre rôle dans "The Woman King" ?
C'est juste un camée. Je ne joue pas un grand rôle. Mais c'est l'histoire de l'armée amazonienne, qui a été créée dans mon pays par la reine [Hangbe], qui a pris la place de son frère jumeau, Akaba. Quand Akaba est décédée, elle a pris le relais et a créé une armée de femmes - et, bien sûr, elles l'ont retirée du panthéon des leaders.
Vous avez enregistré de la musique avec des descendants des Amazones au Bénin.
Absolument. C'est un sujet très important pour moi car s'il est vrai que la plupart du temps les hommes partent à la guerre, les femmes ont souvent combattu à leurs côtés. Et le fait que personne ne s'en souvienne montre à quel point nous allons effacer les femmes de l'histoire. C'est fou. Comment pouvez-vous justifier votre être d'homme, si une femme n'est pas au centre de celui-ci ? Qui vous a amené dans cette vie ?
Quel est votre prochain projet musical ?
Une œuvre de théâtre musical dont la première aura lieu au mass moca en mars. La pièce parle de Yemandja, la déesse de la mer, et d'Oro, le dieu du vent, tous deux parlant de la traite des esclaves. Ma fille a écrit le livret. Kerry James Marshall fait le décor.
Vous avez également travaillé avec lui sur la couverture de "Remain in Light", votre hommage aux Talking Heads.
Oui. Il a dit : "Tu vas être le marchand de lumière !" C'est la couverture - moi, je vends de la lumière au coin d'une rue au lieu de drogue.
Et un autre disque va bientôt sortir, la Symphonie n° 12 de Philip Glass. Elle a été commandée pour la centième année du LA Philharmonic, et ils lui ont demandé de terminer sa trilogie basée sur la Berlin [Trilogie] de David Bowie. Il a dit: "Je ne le ferai que si Angélique est la soliste." Puis il m'a appelé et m'a dit : « Devine quoi ? Je t'ai jeté sous le bus. C'est compliqué .

« Comment pouvez-vous justifier votre être en tant qu'homme, si une femme n'est pas au centre de celui-ci ? Qui vous a amené dans cette vie ? dit Kidjo. Photographie de Rodolfo Sassano / Alamy
Tu es devenu chanteur à six ans. Comment as-tu commencé si jeune ?
Eh bien, ce n'était pas mon fait. Ma mère a monté une troupe de théâtre. J'étais toujours entourée d'actrices et d'acteurs, et j'étais fascinée par leur transformation en personnages. Quelqu'un avec qui vous parliez il y a deux minutes est devenu un autre être. J'étais comme une éponge, rassemblant tout, sentant toute la craie qu'ils utilisaient pour se maquiller. Et je connaissais la réplique de tout le monde, alors quand vous faisiez une erreur, vous entendiez ma voix derrière vous disant : « Non, ce n'est pas la phrase.
Les pièces duraient deux heures et demie ou trois heures, alors ma mère mettait la musique et la danse au milieu, parce que si tu fais un entracte pour un long spectacle, en Afrique, les gens partent. Ils ne comprennent pas l'entracte. Je n'arrêtais pas de demander à ma mère : « Cette petite fille qui joue la princesse et qui chante, pourquoi ça ne peut pas être moi ? Et, un jour, cette petite fille n'était pas là. J'étais dans la loge, en train d'essayer les costumes et de jouer, quand, tout à coup, ma mère m'a attrapé. « Alors tu veux être cette petite fille ? Allez." Je suis, comme, « Non, je ne veux pas. Je ne suis pas prêt. Ma mère, comme, "Tu vas monter sur scène!"
Je n'avais jamais ressenti ce genre de peur. Mon squelette tremblait. Mais la bonne partie était que tout était sombre. Je n'avais que les projecteurs et, pour moi, si je ne vois personne, ils ne sont pas là. Alors j'ai fait ce que je faisais à la maison : j'ai chanté et je suis parti. Il y a eu une ovation debout et le lendemain, j'étais tellement content de moi. Ça m'est tombé dessus, la liberté que tu as sur scène pour chanter, juste chanter.
Dès le début, tu chantais dans tant de langues différentes—
Et j'invente ma propre langue quand je ne comprends pas la langue !
C'est vrai! Comme votre mot "batonga" - "lâchez-moi." Vous avez donc grandi à Cotonou, une ville assez animée, dans les années soixante et soixante-dix. Quelle était la culture musicale ? A quoi avez-vous été exposé ?
Jésus-Christ, tellement. Nous avions de la musique de la RDC (République démocratique du Congo), du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Nigéria, de Cuba, d'Amérique, d'Angleterre, de France, de Chine, partout dans le monde. La maison de mon père et de ma mère était un forum ouvert, et la musique était au centre.
Et j'ai eu de la chance que mon frère aîné et moi ayons dix ans d'écart. Il apportait toute cette musique et j'étais absorbée par elle : Miriam Makeba, Aretha Franklin, Wilson Pickett, Otis Redding, Sam Cooke, les Rolling Stones, les Beatles.
Vous avez vu Celia Cruz jouer quand vous aviez environ seize ans. Comment était-ce?
Celia Cruz était la patronne, je vais vous le dire. En grandissant, j'ai toujours pensé que la salsa était une musique d'hommes, pour les hommes. Parce que, si vous regardiez autour de vous, la plupart des groupes de salsa étaient dominés par les hommes.
Elle a changé cela.
Celia a dit : « Attendez une minute », et cela a complètement changé ma vision de la musique. Si elle pouvait avoir un groupe d'hommes, et qu'elle était la patronne en leur disant : « Allez, vous allez là-bas, vous allez sur le pont » - à partir de ce jour-là, j'ai dit : « Il n'y a pas une seule musique sur cette planète que je ne peut pas faire.
Sa voix n'est pas seulement une voix chantée. C'est un instrument, une percussion. Quand elle a dit "Azúcar !" J'étais, comme, "De quoi parle-t-elle?" Quand je faisais « Celia » [l'album hommage de Kidjo en 2019], j'ai découvert que, parce que les gens [racistes] l'appelaient « café con leche », elle a dit : « Café con leche ? Tu as besoin de sucre, mon garçon. Je l'aime.
Tu es devenue une star au Bénin et dans plusieurs pays voisins à seulement vingt et un ans, après la sortie de ton album "Pretty" (1981). Comment est-ce arrivé?
Eh bien, je jouais avec mon groupe de lycée. Tous les lycées organisaient des compétitions, et nous gagnions toujours.
Il y avait un musicien du Cameroun qui s'appelait Ekambi Brillant. C'était une grande star du makossa, et quelqu'un lui a dit : « Tu devrais venir écouter cette fille. Il est venu à l'une de mes émissions et mon père a dit : « Nous cherchons un producteur. Tu veux faire un album ? Il a dit que ça allait coûter cette somme d'argent—mon père ne l'avait pas. Mais, à l'époque, tout le monde pouvait contracter un prêt pour aller au lycée, et c'est devenu mon financement pour produire l'album. Je devais aller à Paris, et nous avons enregistré "Pretty" en une nuit. Je suis entré en studio à huit heures et j'ai fini à cinq heures du matin, car le lendemain, je devais repartir.
Mathieu Kérékou a pris le pouvoir en 1972. Vos premiers succès ont rendu un peu difficile votre émigration à Paris. Pourquoi a-t-il été si difficile de partir et comment en êtes-vous finalement sorti ?
Sous la dictature, il fallait une autorisation pour quitter le Bénin, et si vous ne reveniez pas, vos parents étaient responsables. Quand j'ai décidé de partir définitivement, en 1983, je n'ai pas pu demander l'autorisation. Je mettrais mes parents en danger.
Nous avons donc secrètement planifié - il a fallu un an pour mettre de l'argent de côté. Personne ne le savait à part ma mère, mon père, la mère de ma mère et mon frère, qui habitait Paris et allait me faire passer de l'autre côté.
Kérékou était du nord, et il y a toujours eu des frictions entre le nord et le sud. Il y avait une méfiance totale, même dans notre maison. Vous ne pouvez pas parler librement. Vous ne savez pas si votre téléphone est sur écoute. Si quelqu'un est là, vous devez l'appeler "camarade". Tout ça me rendait dingue. J'ai dit : « Ma mère n'est pas ma camarade. Mon père n'est pas mon camarade.
Quand je suis arrivé à l'aéroport, j'ai eu de la chance qu'un gars du sud – un ami de mon frère, ils faisaient de la musique ensemble – soit de service. Il a juste dit : « Je ne t'ai pas vu. Courir." Alors j'ai couru jusqu'à l'avion et je me suis faufilé sous le siège. Quand vous êtes jeune et que vos os fonctionnent encore, vous pouvez très bien vous replier.
Tu as de la chance qu'il soit fan !
Cela aurait pu aller complètement dans l'autre sens. Et le plus drôle, c'est que, onze ou douze ans après mon départ, j'étais dans une émission de radio au Bénin — mon album « Logozo » était sorti — et l'homme m'a trouvé et m'a dit : « Je suis tellement fier de voir ce que tu est devenu." Il était à la retraite et m'a dit : « Tout le monde a été promu, sauf moi. . . . Je suis sûr parce que je t'ai laissé partir. Mais je ne le regrette pas du tout."
Il sonne comme un homme bon. Quel accueil avez-vous eu à Paris ?
Ma première expérience a été très douloureuse. C'était le printemps et j'ai attrapé un rhume parce que je portais mes vêtements d'été. C'était l'accueil de Paris : « Petite amie, tu ne portes rien de tel ici. Je suis ici pour vous apprendre que soleil ne veut pas dire chaleur. Et, bien sûr, quand je me suis inscrit à l'école de musique, les gens ignoraient tout de l'Afrique. Ils m'ont demandé : « Quand tu fais tes courses, tu y vas à dos d'éléphant ? Et j'ai dit: "Oui, et j'ai des singes qui portent mes courses." Et ils y ont cru ! J'en savais plus sur le pays de mes camarades qu'eux-mêmes sur mon pays. Et j'ai commencé à me demander pourquoi, au Bénin, on nous avait appris que nos ancêtres étaient les Gaulois. Parce que nous avions été colonisés. Nous avions été réduits en esclavage.
Vous avez également mentionné que des camarades de classe au CIM vous ont dit que le jazz n'était pas pour les Africains.
C'était amusant. Mais rien ne m'a jamais arrêté. Et le fait est que je suis désolé pour les gens qui sont ignorants. Parce qu'une grande partie de qui vous êtes vient d'Afrique. Si vous ne voyez pas la beauté de l'Afrique, il n'y a pas de beauté en vous.

"Cela m'a échappé, la liberté que vous avez sur scène pour chanter, juste chanter", dit Kidjo. Photographie de David Redfern / Getty
Dans votre autobiographie , vous écrivez sur Paris dans les années 80 comme une « période magique où est née ce qu'ils appelaient la musique du monde : les rencontres des grands requins des studios parisiens avec les virtuoses de la musique africaine et caribéenne ». Qui vous a influencé dans cet environnement ?
L'album "Soro" [1987] de Salif Keita a changé la donne. On m'avait dit que je n'étais pas assez africain dans ma musique, et ça m'a montré que j'étais sur la bonne voie en mélangeant tout. À l'époque, il y avait des gens qui disaient : « La modernité n'est pas pour les Africains. Leur musique traditionnelle doit rester telle qu'elle est. Comme si nous devions tous être assis dans un musée. Je suis, comme, "Es-tu fou?" Si notre musique traditionnelle n'était que cela, elle serait morte depuis longtemps.
Votre premier album avec Island Records, « Logozo », a atteint la première place des palmarès des musiques du monde. Qu'avez-vous voulu accomplir avec ?
Quand j'ai signé avec [le co-fondateur] Chris Blackwell, c'était le début d'une belle collaboration. Il m'a aidé à choisir le producteur, Joe Galdo, de [Gloria Estefan's] Miami Sound Machine. J'ai expliqué à Joe que le son de cet album, la pièce maîtresse de celui-ci, était la percussion et la voix. Nous avons dû construire à partir de ce terrain. Parce que c'est de là que je viens. Je viens d'un pays de percussions. Nous n'avons pas beaucoup d'harmonie, mais le rythme est ce que je respire.
La première chanson que nous avons faite comme ça, il m'a regardé et a dit: «Oh, mec, c'est excitant. Je n'y avais jamais pensé auparavant. Toutes les chansons de l'album - "Batonga", "We We" - ont toutes commencé avec des percussions. Il a laissé le claviériste, et tout le monde, être libre. Et j'ai dit : « C'est ce que je veux que tu sois : je veux que tu sois libre. Je veux que vous laissiez cette musique vous guider vers d'où vous venez. Et c'est ainsi que "Logozo" a commencé.
J'ai trouvé ma propre tenue pour la couverture à cause de tous les clichés et de l'exotisme autour des femmes africaines. Les gens s'attendaient à ce que je porte un boubou. Mes parents ne m'ont pas élevé dans un village ; ils m'ont élevé dans une ville. Tu vas pas me mettre dans un boubou, mec.
Alors vous avez opté pour le catsuit à imprimé zèbre.
Je l'ai trouvé dans un magasin et j'ai dit: "C'est ce que je veux."
Vous l'avez décrit comme un look Pop-art.
Bien sûr. Modernité et exotisme, ça vous tente ? C'est ma façon de faire. J'ai ouvert la voie à de nombreux jeunes artistes pour qu'ils portent ce qu'ils veulent porter. J'ai aussi décidé de me couper les cheveux en 1985. Quand je suis arrivé à Paris, j'avais les cheveux longs mais je n'avais pas d'argent. Je ne voulais pas dépenser l'argent du loyer pour mes cheveux. Alors je suis allé au salon où je travaillais et j'ai dit: « Coupez tout. Et le coiffeur a imaginé la même coiffure que Grace Jones.
Ce n'était donc pas une déclaration ?
Non. Je m'en foutais.
Votre première nomination aux Grammy était pour la superbe vidéo "Agolo", qui comprend une mascarade Zangbeto et la divinité serpent Ayida-Weddo. De nos jours, les religions africaines sont référencées dans tout, des films de super-héros à la " Lemonade " de Beyoncé. Mais aviez-vous des précédents, à l'époque, pour ce que vous faisiez avec la spiritualité et la musique populaire ?
Je viens d'un pays avec une culture massive. Même en tant que Béninois, je ne peux pas vous dire que je sais tout, c'est un processus d'apprentissage. «Agolo» - qui signifie «s'il vous plaît» - consiste à prêter attention à la Terre Mère. J'ai commencé par ça quand j'étais enceinte. Les Zangbeto sont des milices utilisées pour protéger les villages. Ils sont ancrés sur la terre. Ayida-Weddo, le serpent arc-en-ciel, dans notre religion, est l'anneau qui porte la terre. Je parle de la façon dont nous devons prendre soin de la terre. Et parce que les gens ne parlent pas ma langue, j'ai dû utiliser l'imagerie de ma culture.
Je sais que le réalisateur de la vidéo était Michael Meyer, mais je suppose que vous avez été très impliqué dans la création de son esthétique.
[Meyer] connaissait vraiment bien mon pays. Sa femme à l'époque était originaire d'Haïti. La chorégraphe, Kettly Noël, était également originaire d'Haïti. Nous avons eu une longue discussion sur nos dieux et déesses, la traite des esclaves, les dieux qui sont allés de l'autre côté. Ayida-Weddo est la même en Haïti, et, parce que la plupart des esclaves en Haïti venaient de mon pays, les deux cultures se rencontraient pour raconter l'histoire. Nous avons donc utilisé tout cela pour raconter une belle histoire de résilience.
Venons-en au langage. Les gens parlent de vous fusionnant la musique « africaine » avec des sons européens, brésiliens et cubains, mais ils ne réalisent pas toujours à quel point vous faites de la fusion entre différentes langues et cultures au Bénin. Je sais que les deux langues dans lesquelles vous chantez le plus souvent sont le fon et le yoruba. Comment choisis-tu les langues de tes chansons ?
C'est une question d'inspiration. Parfois, vous essayez une langue et cela ne fonctionne pas. Si une chanson doit être rythmée, vraiment tendue, elle doit être Fon, car c'est la langue des Amazones. Yoruba - ou Mina, du Ghana et du Togo - contient une mélodie. Mais je ne peux pas m'asseoir ici et vous dire que c'est fait exprès.

« Il y avait des gens qui disaient : 'La modernité n'est pas pour les Africains. Leur musique traditionnelle doit rester telle qu'elle est' », déclare Kidjo. "Je suis, comme, 'Êtes-vous fou?'" Photographie de Paul Bergen / Redferns / Getty
Dans votre autobiographie, vous parlez de l'exaltation de votre premier grand concert après votre retour au Bénin, "le seul endroit au monde où le public pouvait chanter et comprendre chaque mot" de votre musique. Je me demande si cela a déjà été un défi pour vous de vous adresser à un public mondial dans les langues de votre pays.
Non, car la musique est un langage universel. Les douze notes sont là pour tout le monde, et ces notes ne font pas de discrimination.
Vous avez travaillé sur le terrain tout en préparant des albums comme "Fifa" et "Eve" (2014). Comment construisez-vous des relations avec ceux dont vous apprenez? Demander aux gens de partager la musique de leurs communautés peut être une demande assez intime.
C'est beaucoup de travail. Mais je n'ai pas d'autre objectif que de chanter ensemble. Quand j'ai fait le voyage pour "Fifa", ça a été un réveil pour moi. J'avais un chauffeur formidable qui venait du nord du Bénin. Nous sommes allés en profondeur, à Korontière, Djougou, Kandi. Je ne parlais aucune de ces langues et la plupart de ces endroits n'avaient pas d'électricité. Nous avons dû acheter une deuxième batterie de voiture, car nous branchions tout sur la batterie de la voiture pour avoir notre enregistrement.
C'est la première fois que j'ai vu à quel point j'étais aimé dans mon pays. Chaque fois que vous arrivez dans un village, un petit garçon ou une petite fille vous voit : « Angélique Kidjo est là ! - et tout le monde sort. J'expliquais toujours ce que je voulais faire et je leur disais : « Je dois vous payer. Ils disaient non, et je disais : « Si je ne te paie pas, je ne le fais pas. Le plus dur a été de les faire accepter d'être payés, et de me donner leurs noms pour qu'ils soient reconnus sur l'album.
Mais je viens de cette culture, et rien d'autre n'a de sens sans elle. Si je ne comprends pas quelque chose, ma seule boussole est d'aller voir des musiciens traditionnels et de dire : « Pouvez-vous jouer cette musique avec moi ?
Vous avez continué à voyager pour la trilogie sur la diaspora : « Oremi » (1998), « Black Ivory Soul » (2002) et « Oyaya ! (2004). Comment est née l'idée de ce projet ?
Quand j'avais neuf ans, mon frère portait une perruque, mettait Jimi Hendrix et jouait de la guitare. Et je disais : « Il est Africain, n'est-ce pas ? Dans quelle langue chante-t-il ? Mon frère a dit : « Non, il est afro-américain. J'ai neuf ans, pensant que je sais mieux que quiconque, alors j'ai dit : « Comment est-ce possible ? Vous ne pouvez pas être Africain et Américain en même temps. Et puis il a dit: "Eh bien, c'est un descendant d'esclaves." J'ai dit : « Qu'est-ce qu'un esclave ? Qu'est-ce qu'un descendant ? Quand ma grand-mère m'a raconté l'histoire de l'esclavage, je n'arrivais pas à y croire.
Avance rapide, et j'ai quinze ans, j'apprends sur l'apartheid en Afrique du Sud. Et puis c'est juste, comme, « Vous m'avez dit que je peux aller n'importe où dans le monde. Maintenant, je découvre que ma couleur de peau est un handicap. Je peux être tué parce que je suis noir. Je me suis dit : « Il devrait y avoir un moyen de faire quelque chose. L'idée de rencontrer la diaspora à travers la musique est née à ce moment-là.
Mais je savais que ça allait prendre du temps. Au fur et à mesure que je grandissais et que j'apprenais davantage, j'ai décidé qu'il était temps de déménager en Amérique. Je suis allé voir mon éditeur et je leur ai dit que je voulais travailler avec tous les artistes, pas seulement les Noirs, pour raconter l'histoire de l'esclavage, car c'est notre histoire. C'est ainsi que nous avons commencé avec "Oremi". Puis je suis allé à Salvador de Bahia, dans les Caraïbes, à Cuba. Et j'ai simplement dit aux gens : « Ne pas parler de l'esclavage ne le fait pas disparaître. Cela a toujours un impact sur tout ce que nous faisons. Et la façon d'en parler est de construire des ponts entre la culture et les gens, parce que notre histoire est tellement entrelacée.
Beaucoup de vos albums ont été des interprétations de traditions musicales ou, plus récemment, d'artistes particuliers. Avez-vous une philosophie sur la façon de couvrir la musique? Comment s'approprier une chanson comme « Voodoo Child » d'Hendrix, tout en respectant son esprit ?
J'essaie toujours de trouver une idée originale qui rendra la chanson complètement différente, mais une fois que c'est fait, j'essaie de respecter la mélodie originale. Pour "Voodoo Child", l'idée était de remplacer les riffs de guitare par un chant traditionnel béninois - et, comme par magie, cela a fonctionné.
Comment avez-vous abordé "Remain in Light" (2018)
L'album Talking Heads a commencé lorsque j'ai entendu "Once in a Lifetime" pour la première fois, trois mois après mon arrivée [à Paris]. J'avais toujours le mal du pays et le refrain ressemblait tellement aux chansons que nous avions jouées [à la maison]. Les années ont passé, et je n'ai jamais, jamais lié David Byrne à ça, même quand j'ai rencontré David, en 1992. Je ne l'ai pas assemblé jusqu'à ce qu'un jour, je fredonne la chanson et dis : « J'ai besoin de trouver cette chanson. et fais-le. Et un de mes amis m'a dit : « C'est les Talking Heads. C'est un album emblématique, "Remain in Light". ”
J'ai vraiment commencé à écouter l'album pour la première fois il y a quatre ou cinq ans. Et j'ai dit: "Je vais faire tout l'album." Les gens me regardaient, genre : « Es-tu fou ? Ces chansons n'ont aucun sens. Ce sont de longs mots absurdes. . . .” J'ai dit : « Vous n'avez pas grandi avec des personnes âgées qui vous parlaient de proverbes qui mettent des mois à comprendre. C'est facile. Je le fait."
Je venais de terminer l'album « Eve », quand je suis allé en Afrique pour faire chanter des femmes avec moi. ["Eve" présente des collaborations avec plusieurs chœurs traditionnels béninois.] J'ai découvert que les Talking Heads étaient influencés par l'album "Afrodisiac" de Fela Kuti. Alors j'ai dit : « Eh bien, ramenons ça à la maison. Je ferai répondre les voix de ces femmes à la musique des Talking Heads. Ainsi, "Born Under Punches" va de pair avec un proverbe Fon qui dit : "Méfiez-vous lorsque vous allumez un feu, car si vous ne savez pas comment arrêter ce feu, il vous dévorera." "Born Under Punches" parle de corruption. La corruption nous tue, car l'argent est détourné de l'éducation, de la santé, des infrastructures. Cette corruption va tous nous manger. Alors c'est comme ça que j'ai fait, une chanson après l'autre.
Sur votre album hommage « Celia », qui a remporté un Grammy en 2020, il y a une version de « Quimbara » qui sonne comme un défilé de retour africain pour une chanson cubaine. Je voulais vous poser des questions sur les changements que vous avez apportés, notamment au rythme de la chanson.
J'ai pu faire l'album avec un producteur martiniquais. La conversation que nous avons eue était - un album de salsa, je ne peux pas faire mieux que n'importe quel Latino. Je suis africaine, je veux rendre hommage à la puissance africaine de Celia Cruz. C'est comme ça qu'on a commencé à travailler : je lui envoyais juste ma voix, et il construisait la chanson. Parce que " Quimbara ", vous pouvez battre 6/8 et 4/4 dessus. Donc le 4/4 est une partie, et le 6/8 qui vient d'Afrique est là. J'ai donc réuni les deux dans une même chanson, en passant de l'une à l'autre, pour montrer à quel point c'est facile. Si vous laissez la musique être, c'est formidable.
Le rythme est si important pour votre musique. Et pourtant, certaines de vos chansons les plus puissantes sont orchestrales : « Londres », votre interprétation du « Boléro » de Ravel ; votre version de "Summertime" de Gershwin ; la version de « Bahia » que vous avez enregistrée avec la Philharmonie du Luxembourg . Qu'avez-vous appris en travaillant à grande échelle comme ça ?
Quand les gens ont commencé à me dire : « Tu devrais travailler avec un orchestre », j'ai dit : « Qu'as-tu fumé ? Puis j'ai rencontré [Gast Waltzing], le chef d'orchestre luxembourgeois, au Montreux Jazz Festival. Il [a arrangé] quelques chansons comme « Agolo » et « Bahia », et j'ai dit : « Maintenant je vois. OK, allons-y. Nous avons commencé par un spectacle en juin 2012. Ce fut un succès, et j'ai réalisé que chanter avec un orchestre est un jeu de balle complètement différent - il n'y a pas d'amplification, donc votre voix devient l'un des instruments. Et c'est là que vous découvrez les possibilités infinies des cordes vocales. Vous venez de les mettre au travail.
Est-il vrai que vous avez pris la décision délibérée, à l'école de jazz, de ne pas apprendre à lire la musique ?
J'étais à l'école pour apprendre à lire la musique. Mon professeur est venu me voir et m'a dit : « Angélique, je tuerais ma mère et mon père pour ta mémoire musicale. Sors d'ici!" Et je m'ennuyais, je vais vous dire que - do re do re do re mi , je n'aimais pas du tout - alors j'ai dit : "Merci, monsieur !" et s'élança. J'étais si heureux. J'aurais aimé rester un peu plus longtemps, car la musique écrite, quand on travaille avec des musiciens classiques, c'est plus facile. Mais ma mémoire m'a aidée.
Le nouvel album, « Mother Nature », qui est également nominé aux Grammy Awards, présente plusieurs collaborations avec les nouvelles stars du continent—Burna Boy, Yemi Alade. Si vous débutiez votre carrière aujourd'hui, vous sentiriez-vous capable de le faire chez vous, en Afrique ? Ou partiriez-vous encore pour Paris ?
Si c'était toujours la même dictature que j'ai fuie ! Mais, si la technologie d'aujourd'hui avait existé, je serais probablement encore chez moi. La jeune génération n'a pas à migrer pour faire carrière. S'ils décident de quitter le pays, c'est de leur plein gré, car ils savent qu'ils peuvent y retourner.
Comment avez-vous développé le concept de l'album ?
J'ai grandi avec ma grand-mère, herboriste, qui me disait qu'on n'est rien sans la terre. Et le changement climatique a vraiment un impact sur les plus pauvres des pauvres de mon continent. J'entends des gens dire qu'il faut arrêter d'utiliser du bois pour cuisiner. Nous savons qu'il est mauvais de couper des arbres. Mais quelles alternatives proposons-nous ? On va dire aux pauvres, en plus de la pauvreté, il faut s'asseoir et se regarder mourir de faim parce qu'on veut sauver le bois ?
La prochaine génération en Afrique va souffrir le plus du changement climatique, et je ne pouvais pas faire l'album sans leur demander de se joindre à nous. Je voulais leur donner une plateforme pour s'exprimer à travers la chanson. Il est intéressant de voir comment ils vivent l'anxiété de différentes manières. Et cette nouvelle génération, en Afrique, est beaucoup plus consciente des dysfonctionnements du paysage politique.
Votre chanson « Dignity », avec Alade, parle des manifestations #EndSARS contre la corruption et la brutalité policière au Nigeria.
Je n'aurais jamais pensé voir la jeunesse africaine descendre dans la rue et dire : « Assez de ces bêtises. La plupart du temps, ils ne se fiancent pas, parce que la pensée est : "Pourquoi s'embêter ?" Les politiciens sont corrompus, ils ne se soucient pas de nous, et nous ne nous soucions pas d'eux non plus. Mais quand il s'agit de violence contre quelqu'un dans la société, tout change.
Alors tu es optimiste ?
Bien sûr! Toujours. Car le dictateur est, pour moi, fondamentalement un lâche. Si vous voulez vous appeler un leader, vous devez être capable de vous tenir debout et de discuter de votre position.
Dans « One Africa (Indépendance Cha-Cha) », vous revisitez une joyeuse rumba congolaise de l'époque des indépendances, à votre naissance, et lui donnez une tournure troublante : « Les rêves ont été brisés, maman / À qui puis-je faire confiance, maman ? ” Que pensez-vous des perspectives politiques sur le continent ?
Nous n'avons jamais vraiment eu d'indépendance en Afrique. Je ne sais pas comment nous avons fini par être le continent le plus riche de la planète, avec nos ressources contrôlées par une mafia de pays riches et de PDG. Ils savent que leurs économies ne peuvent pas être durables s'ils n'ont pas accès à nos ressources. Et, si vous n'allez pas dans le sens des intérêts des pays riches – regardez ce qui s'est passé au début de l'indépendance, [avec l'assassinat de Patrice] Lumumba – vous pouvez être tué.
C'est pourquoi la chanson est comme ça. On nous dit d'accepter que les Africains doivent vivre dans la pauvreté pour que le reste du monde vive en grand. Cela ne marchera pas parce que nous méritons mieux. Cette riche mafia de pays, de dictateurs et de PDG a gâché les choses et continue de le faire. Nous devons prendre nos responsabilités et combler le fossé pour construire un système où les ressources sont partagées équitablement et améliorer nos vies.

https://music.apple.com/us/album/iemanja/193090639?i=193091228 https://en.wikipedia.org/wiki/Miriam_Makeba https://en.wikipedia.org/wiki/Brenda_Fassie https:/ /en.wikipedia.org/wiki/Ces%C3%A1ria_%C3%89vora https://www.newyorker.com/culture/the-new-yorker-interview/angelique-kidjo-a-tout-entendu https https://www.amazon.com/Recovering-African-Feminine-Literature-Practice/dp/1793640955/ref=cm_cr_arp_d_product_top?ie=UTF8 https://www.youtube.com/watch?v=3RDaPV_rJ1Y https ://open .spotify.com/album/62DPGNE8CtgV8OKT8BUzZG http://www.kidjo.com/ https://shop.forbesafrica.com/product/single-digital-issue-august-september-2022/
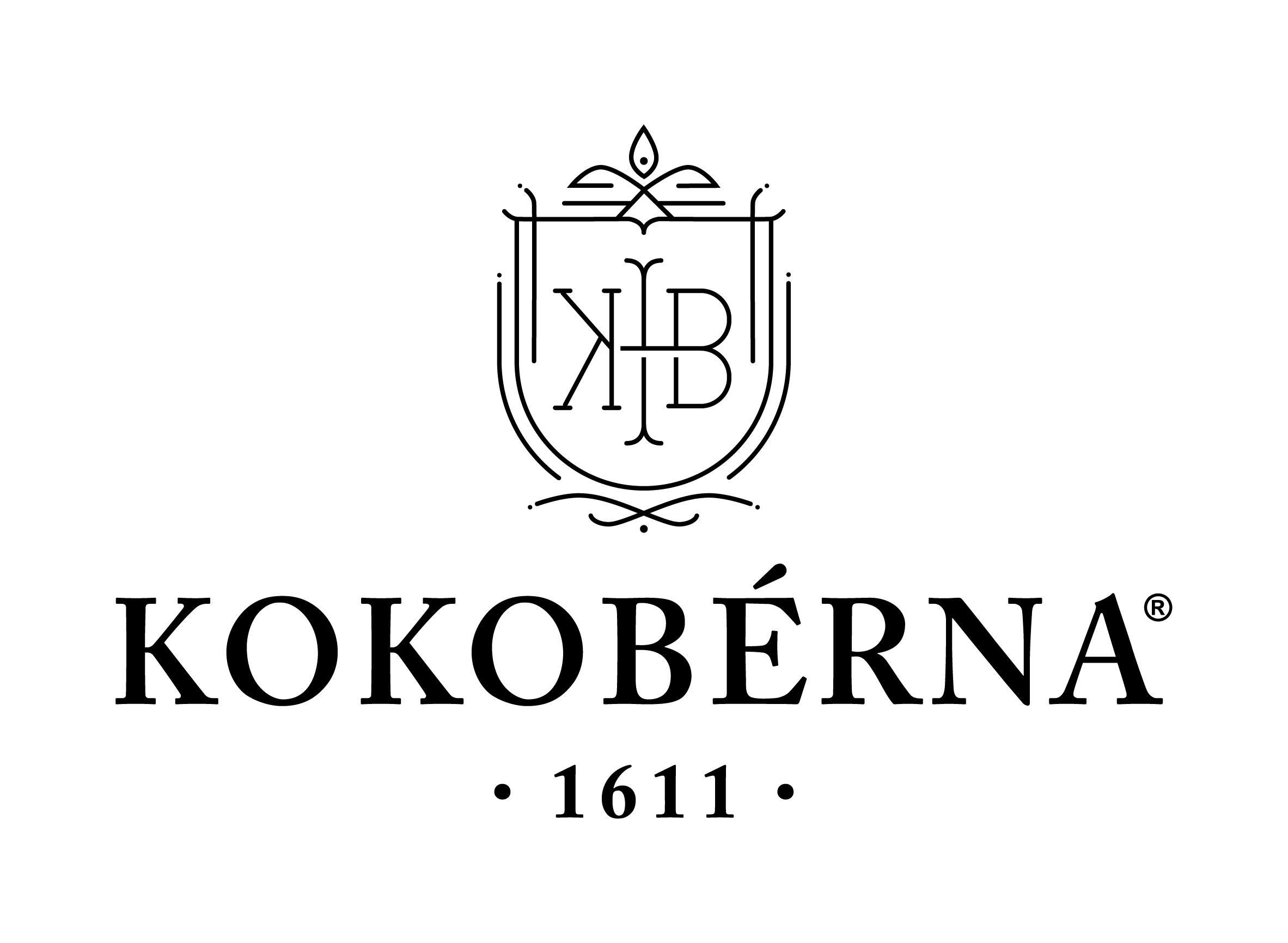




Laisser un commentaire
Ce site est protégé par reCAPTCHA, et la Politique de confidentialité et les Conditions d'utilisation de Google s'appliquent.